Projet très intime, ANA m’a occupé pendant plusieurs années. Exercice presque physique de reconstruction, il est maintenant achevé et si je n’ai jamais vraiment cherché à le publier, malgré quelques tentatives ci et là, tant la démarche semblait vaine, j’en livre ci-dessous quelques extraits. J’irai piocher de temps en temps. C’est là et ce n’est plus là.
FRAGMENTS DU RECIT
En rentrant de Berlin, je me suis arrêté un moment pour fumer et regarder les voitures passer. Je redoutais de te retrouver. Flora, légère et gaie, si pleine de vie, m’a sauté dans les bras. Elle m’a préparé des petits cadeaux, des petits papiers, des dessins. Puis dès le matin, épuisée, tu me l’as redit très fort : je ne pense qu’à moi, je n’en fais qu’à ma tête… Je me suis mis à aimer les nuages et à ne plus savoir vivre sans. Pourquoi je te raconte ça, Ana, je ne sais pas. Je vois les nuages et je pense à toi, Ana, au jour où tu viendras, face à la mer, dans cet endroit où j’habite, où on accède à la plage, puis à l’horizon, ma consolation. Je me promène nu dans ces espaces désolés de la ferraille et des terres calcinées, à partir desquelles nous ferons le monde de demain, je t’espère et te chéris, Ana, charnelle et accueillante, tes taches de rousseur, ton joli minois…

LA NUIT BLEUE
La nuit est bleue au-dessus de l’Arctique et tandis que je me pelotonne dans ma polaire, dans les airs, je pense à toi qui me révèle, enfouis dans la mémoire, les temps prochains qui enfin apparaissent, tu sais, quand je renverse le sablier des trente prochaines années.
Déjà j’avais ce projet nuit bleue, j’aimais bien le titre semblable au navire night, ou du moins dans la même veine que je recherchais, ça me plaisait. Projet à double tour puisqu’il évoquerait mes années rocks résumées par un chant furieux que j’écoutais chez mon ami Laurent F au premier étage du pavillon parental d’où il me toisait sur le chemin du lycée, ce même Laurent dont je lisais stupéfait l’interview dans un vieux fanzine exposé comme une relique, à deux pas de mon gagne-pain, lors de l’expo sur les 40 ans du punk, ce chant furieux d’un certain Violet – gloire locale au patronyme d’aurores boréales- qui hurlait c’est une nuit bleue, l’amour est psychiatrique.
A cette époque-là, je voulais que mon corps vive, mais une forme d’angoisse venue d’on ne sait où jamais ne lâchait, une stupeur, un empêchement. J’allais à la bibliothèque municipale découvrir au casque les spasmes de John Foxx guerroyant dans la nuit, I Want to Be A Machine, les voyages ferroviaires de 154. J’écrivais des phrases dans ma chambre d’enfant, I should have known better. Tout allait bien dans mon monde en larmes, avec mes amis, nous errions, tout de noir vêtu, dans le brouillard, entre l’éther et la bière. Les choses se sont dégradées sans que je m’en rende compte, dans cet espace banlieusard qui à sept heures du soir, fermait les volets dans le froid & le noir…
2 ans plus tard, enfin apaisé, ça m’a frappé comme une évidence, déambulant seul le long de la rue des Vallées tandis que je me dirigeais vers la passerelle de la gare du même nom, qu’Isa n’aimait pas parce qu’elle y ressentait le vertige, et qui fut remplacée par un souterrain peu de temps après ; l’espace, à nouveau rénové, est désormais encadré par 3 ascenseurs et parcouru par les ombres de la nuit, caquette et clope au bec, qui sautillent autour de mes 50 ans, la mesure du temps qui passe, à 10 minutes de Saint Lago. Je voulais avoir des enfants comme une rédemption, une solution, je savais que je m’en occuperais bien, je leur donnerais de l’amour, celui que j’avais en moi et que je ne pouvais donner à personne. Des petits bonshommes semblables à mes rêveries, des petits êtres mélancoliques, nous nous comprendrions, comme nous nous étions compris, mon petit frère et moi en son jeune temps. Cette pensée m’avait traversé l’esprit pour ne plus jamais me quitter …

LES CIGOGNES
A Izmir, je m’imagine me réveillant après une escapade nocturne sur le rafiot qui nous trimballe vers je ne sais quelle aventure. Je me rappelle ouvrant les yeux, les lumières du Port à l’embouchure comme une des cent images fantasmées de mes temps anciens, ceux d’avant la couleur, au tout début inaugural, où nous traversions la Turquie. Je me rappelle les jours maussades, les premières cigognes voletantes qu’on me faisait admirer, d’arrêts en des terres improbables, d’angoisses qui parfois me montaient. Plus tard, lorsque nous aurons rejoints le Paris des temps préhistoriques, un grand pavillon face à celui plus modeste de mes parents, une cigogne en plâtre sur le toit, surplombant la voie ferrée désaffectée. Toujours, j’ai voulu de l’Orient chez moi, des tapis, du narguilé et des petits cigarillos, sans trop d’excès, l’odeur du café, le chant des oiseaux tournoyant au passage des fleurs tout près d’Istiklâl Caddesi.
a defaut d’ana
Bleu comme l’éther hier, j’envisageais alors un large monochrome rouge aspirant en un éclair circulaire espoirs, désordres et certitudes sous une mélopée douce-amère, me transportant aux confins du monde, une vie sans aspérité, dans la contemplation des étoiles et de l’infini. Je me noyais dans les écrits d’un philosophe italien proclamant « il n’y a pas de maisons ontologiques, il n’y a que des migrants sur la Terre, car la Terre est une planète, un corps constamment à la dérive dans le cosmos ; nous sommes désormais libérés de cette illusion de la toute-puissance, qui nous fait nous imaginer comme le début et la fin de tout évènement planétaire », persuadé, avec Pacôme Thiellement, que le combat entre les Lumières et les Ténèbres jamais ne cessera et qu’il faut combattre avant toute chose « ce monde horrible où tout bonheur individuel s’obtient à partir du malheur des autres », pour qu’émerge enfin l’autre Univers.
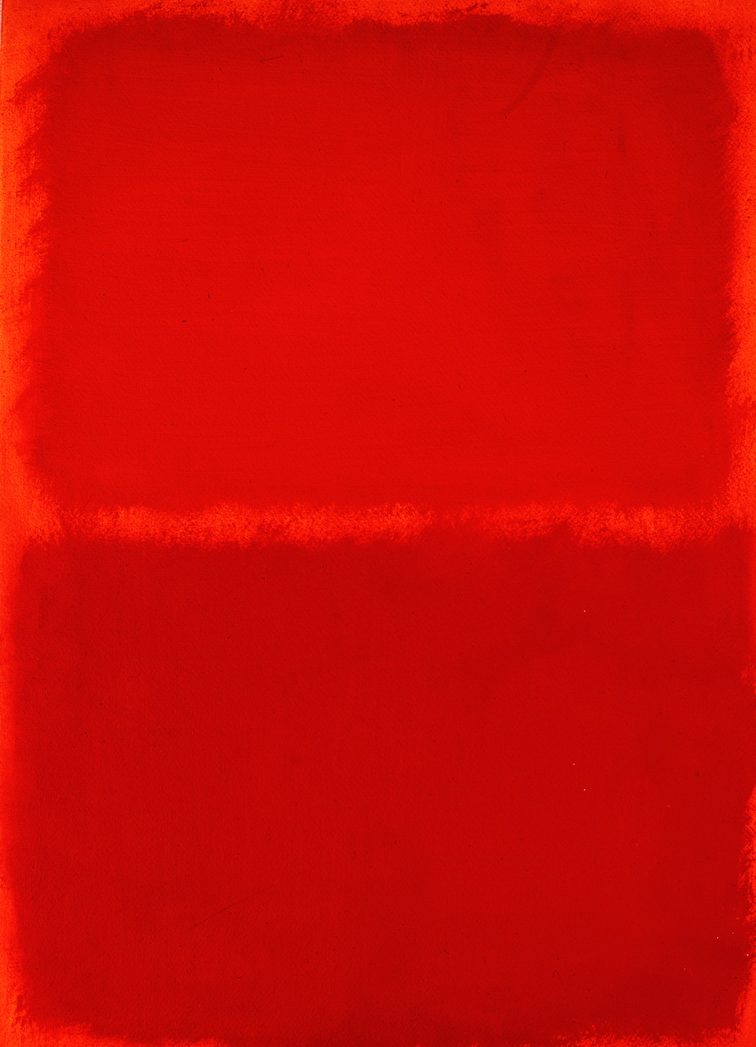
LES JOURS DU JAGUAR
Je me rappelle ce rêve de toi, pleine de gaieté, qui me prends la main, qui me souris, cette chaleur qui s’abat tout à coup dans la nuit. Je me rappelle dimanche matin, mes 4 petits enfants dans la rosée, de la lumière dans le jardin. Tu danses devant nous, ma petite fée, un spectacle, où tu nous as convoqués. Je vois tes petits bras qui font un cercle délicat tandis que tu t’élances, tes regards discrets, ton sourire timide, que tu corriges d’un rire désarmant quand tu prends confiance. Comme tu as grandi, cette belle promesse que ta vie qui semble déjà t’appartenir.
J’entre alors dans la chambre rouge. Dans cette pièce confortable, tout est amitié, redevient tactile, respire l’intelligence, la part de mystère en nous que l’on reconnait instantanément. C’est si simple, si beau, si doux. On se serre les coudes. On sait de quoi on parle. Sur les fauteuils en cuirs, derrière les rideaux de velours, au creux des sycomores, on écoute Jimmy Scott.

Je sais que demain, je reprendrai ma basse, tout en noir je m’enfermerai avec mes deux compagnons de nuit et nous bidouillerons sur de petites machines, rythmes et batterie. Au mitan de la nuit, quand toutes les lumières se seront éteintes, surgira une furie, Allée Sauvage de Beak, qui tournera en boucle dans la pièce capitonnée, quelques amis, des inconnus, des filles qui dansent sans s’arrêter, la transe qui monte, la chaleur, les yeux dans le vague : ce que nous célébrerons traversera les océans, la skyline des mégapoles, les déserts, les hommes fuyant le précipice, marquera la matrice des temps.
L’ECRITURE AUTOMATIQUE
La semaine dernière avec Patrick évoquer un projet d’écriture à partir de ce que je lui raconte d’un passage de David G à un concert de Hugh à Cambridge, qui en parle dans une interview, parmi les multiples textes que je parcours sur eux, et raconte ce moment simple où Dave passe le voir en voisin, comme il joue dans sa ville. Il n’en dit rien d’autre. Mais nous on sait, la séparation, le divorce des Étrangleurs, terrible et décisif, virage absolu dans leur carrière et dans leur vie. On sait le silence perpétuel de Dave, livrant peu de lui et la tendresse nous prend de les deviner échangeant simplement, amicalement, sobrement, ces deux légendes et tout ce qu’elles portent, buvant un coup, se jaugeant de là où elles en sont maintenant, mais peut-être pas, peut-être seule la simplicité l’emporte, la profondeur en quelques mots, quelques sourires, une vanne, lui la gentillesse de venir le voir, l’autre la joie de revoir son ancien équipier dans un contexte décalé, tous les deux prenant des nouvelles, échangeant des regards dont on voudrait mesurer l’intensité, les souvenirs qu’ils portent et dont ils semblent détachés, ils savent tous deux sans doute ce qu’ils se doivent l’un l’autre, ils connaissent le parcours, s’apprécient profondément, ont partagé plus que l’essentiel. Puis l’instant d’après chacun disparaissant dans son couloir, le cœur réchauffé, passant à autre chose. Ces moments qu’aucune histoire officielle ne peut restituer.
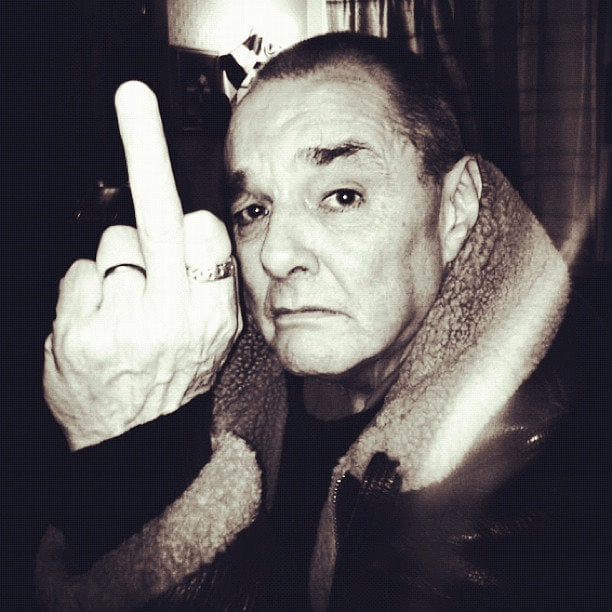
L’ENFANT DE LA LIONNE DE K
Te rappelles-tu l’enfant de la lionne de K. Il était beau, dormait sur la plage, le matin passait entre les sun-bed, quêtant la monnaie, hébété, encore endormi, parfois nous oubliait, nous souriait et s’en allait. C’était un enfant brun du soleil, un frère en muscle dont j’enviais la liberté et la beauté. Sa mère dirigeait l’espace qui tenait lieu de café dans ce paradis immaculé, terrain de volley, de fêtes qui semblaient réservées à ceux qui avaient choisi de vivre comme des Dieux, petites tables à l’ombre, bivouac improvisé où la vie pouvait reprendre, parsemé de peintures et objets peints & sculptés par son père, lui-même dans la plénitude, je le voyais. Une fois je me rappelle, je m’y étais protégé de la pluie et nous étions les quelques-uns, habituellement nus et rougis au soleil, ici maladroitement recouverts de textiles en tous genre, souriant et se découvrant hagards dans cet éden soudain transformé en arrêt de bus maussade & heureux. Parfois les enceintes étaient tournées vers le large et les basses reggae nous berçaient tandis que nous nagions au ras de l’eau, chaloupaient quand je plongeais tout entier pour célébrer au rite de K, m’immergeant complètement dans la mer bienfaitrice. La lionne avait été magnifique, je le voyais…Je me rappelle le long du chemin, tandis que nous remontions de la plage de K, mon enfant et moi, lui sur mes épaules … Je m’étais arrêté pour la contempler. Je me retourne à nouveau (…) Plage d’éternité. On aimerait qu’une caméra immobile ait fixé pour l’éternité les scènes dont elle fut le témoin, là un homme affamé dans les siècles de solitude, ici un duel lors d’une guerre oubliée, plus loin un couple sans âge conduisant de maigres bêtes, des chèvres, un âne isolé dans le cosmos, un bateau qui accoste, des hommes qui se précipitent, un assassinat sauvage, le sang rouge qui jaillit et toujours le silence, des dizaines, des centaines d’années de silence et d’immensité, le soleil, la lune, la neige, le froid puis l’été, la chaleur, un kouros grec, un athlète musclé venu de nulle part, parcourt la plage de K il y a 2 500 ans. Enfin, à l’orée du siècle, les premiers visiteurs, des milliers maintenant. Savent-ils que lorsque j’étais enfant, nous n’étions que quelques-uns à connaître l’existence de K, à en apprécier le secret, que nous rompions le dimanche en famille. Comment sera-t-elle, cette plage, dans 10 000 ans ? Quand la terre implosera, nous serons là, sur son tapis, le sable orange, face à la mer, nous verrons à l’horizon venir à nous la déflagration, nous aurons alors une dernière pensée pour la lionne, nous les hommes de K, immobiles face à l’éternité qui s’achève. Nous nous retrouverons sur la terre des origines au moment de basculer.

… Ces zigs et ces zags bâtissent une maison instable où je picore, des Étrangleurs aux livres, des livres aux enfants, les grands comme les petits, les filles, les garçons, des enfants aux parents, toute cette construction, la sérendipité comme ligne de conduite…
La COULEUR JAUNE
Jaune encore était le cendrier que je ramenais du troquet de Pasolini au cœur de Pigneto, à Rome, le même que l’on retrouve sur la couleur du Poche de ses Écrits Corsaires, et que je me plais à chercher sans toi lors d’un samedi désœuvré, parcourant la maison en ces 5 pièces inégales. Sur ce beau tapis marocain que tu voulais mettre à la casse, l’imposant dans la pièce que les enfants appellent désormais chambre noire, bureau et salle de cinéma à la fois, on voit un soleil jaune-vert éclatant dont le fil fragile fût tissé au XIXème siècle par quelques femmes de bergers célébrant les cieux de leur savoir-faire ancestral. C’est ce que je retins lors de son achat. Jeune alors, je le crus et le crois encore, car j’ai bon cœur. Il repose et vieillit peu à peu avec moi, m’accompagne de sa lumière chamanique, de son silence absorbant lors de mes siestes méridiennes. Du jaune encore, dont tu avais badigeonné une des portes du couloir, celle qui donne sur le dressing où j’avais planté la belle affiche au soleil matinal ou couchant on ne sait, rasant et lumineux en tout cas, de Sharunas Bartas « Peace To Us in Our Dreams ». Du jaune sur mes paquets de Montechristo, du jaune sur cette photo de toi & de moi que j’aime en ce moment. Et j’en oublie sans doute, le jaune était partout et je le découvrais tel un Rouletabille de pacotille parcourant la chambre du même nom, la surprise était grande. Dans le café Necci de Pasolini, il était omniprésent, sur les murs, les drapeaux, les affiches, sur le pull aussi que tu portais ce jour-là, comme si vous vous étiez donné le mot…

L’ETAT DE K
Tu parles, ta voix est équilibrée, tu en viens, de ce temps-là, tu vas chercher du pain, c‘est le matin, tu mets un haïku d’Idaho Weight It Down dans la machine, tu as atteint l’État de K. C’est un équilibre qui va durer plusieurs jours, tu le cherchais du côté des basses lourdes, atones, des drones au loin, des nuages que l’on tient en respect.
Les algorithmes me reprennent, je trouve un équilibre dans cette aventure faite d’écriture, d’énergie consacrée à de larges constructions, vie pour vous mes chéris, gagne-pain, gamberge & repos, esthétique de la Life, refus de la laideur. Parfois j’y arrive, tu sais, à faire qu’une journée soit parfaite & que partout le médiocre se soit retiré. A un point qu’il m’est difficile de partager ; je n’ai pas retrouvé les secrets de la gaieté, celle de la multitude qui se déploie sans me regarder, ni prêter attention au temps qui passe ; l’élixir de leur complicité m’est inconnu ; plus j’avance, plus je comprends, nous sommes toutes et tous fourmis dans l’univers, cellules d’un grand tout, d’un magma qui disparait en même temps qu’il renait, perpétuellement, il n’y a rien d’autre que vivre & mourir. Et s’aimer Ana. Découvrir, sentir la beauté, la tienne, celle des formes & des choses, la vie, donner du sens à cette humanité que nous formons, puis disparaître dans la nuit, les étoiles, son épaisse opacité, le grand soir, le grand noir, la lumière là-bas, rejoindre la respiration de l’univers. « Quand nous et toutes nos œuvres aurons disparu ainsi que leur souvenir et la moindre machine dans laquelle ce souvenir pourrait être enrôlé et stocké, et quand la terre ne sera même plus cendres, pour qui donc cela sera-t-il une tragédie » m’interroge John Sheddan. Je reste accroché à mon chemin, j’y dépose mes petits cailloux paradisiaques et extatiques. Tourné vers le sol, vers toi. Et parfois vers le ciel.
Je tutoie le Très Haut, là où je suis arrivé. Au jardin d’Ana où je vis désormais.